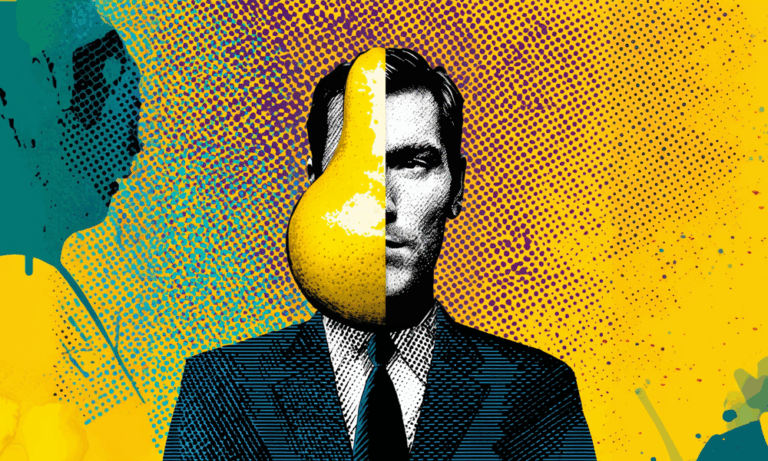Private equity : faut-il se fier aux fonds evergreen ?

Un Private Equity pour tous. C’est l’image qu’ils peuvent donner. En plein essor, les fonds evergreen fluidifient et promettent de démocratiser le capital-investissement. Mais ce nouveau mode d’investissement porte aussi en lui un changement structurel du financement des entreprises. Comment trouver l’équilibre entre risques et opportunités ?
Il a longtemps été perçu comme la chasse gardée des investisseurs avertis. Mais le private equity (capital-investissement) s’ouvre. Sous l’effet de la législation européenne et de l’émergence d’une nouvelle génération de fonds : les fonds evergreen ou semi-liquides, qui pourraient tenter les héritiers des quelque 3 500 milliards d’euros de patrimoine qui devraient changer de main d’ici à 2030.
Encore confidentiels il y a quelques années, ces véhicules d’investissement affichent désormais une croissance de près de 30 % par an. Ils représentent environ 5% du marché mondial du capital-investissement, soit près de 700 milliards de dollars, et pourraient peser quatre fois plus d’ici à dix ans, selon les projections du gestionnaire américain Hamilton Lane.
Les fonds evergreen, un ovni dans l’univers du Private Equity
Le private equity traditionnel repose sur des fonds dits « fermés », qui durent en général une dizaine d’années. Pendant cette période, les investisseurs s’engagent à fournir du capital, lequel est appelé progressivement, investi dans des entreprises, puis récupéré lors des cessions ou introductions en Bourse. Le système est efficace mais rigide : les investisseurs ne peuvent pas récupérer leur argent avant l’échéance, même s’ils ont besoin de liquidités.
À lire aussi : Benoist Lombard : « On ne conseille pas de la même façon un héritier et un self-made man »
Les fonds evergreen fonctionnent autrement. Comme leur nom l’indique, ils sont conçus pour durer sans limite prédéfinie. Les investisseurs (Limited Partners, ou LPs) peuvent entrer et sortir à intervalles réguliers, tandis que les bénéfices sont réinvestis automatiquement. En pratique, cela signifie que le gestionnaire (General Partner, ou GP) n’est plus contraint par un compte à rebours de dix ans. Il peut accompagner une entreprise sur le long terme, sans la précipiter vers une sortie artificielle.
Époque liquide, fonds liquide
Le succès des fonds evergreen tient à une évolution des attentes. Les grands investisseurs institutionnels (LPs), mais aussi de plus en plus d’épargnants particuliers, veulent accéder au private equity sans se retrouver piégés par un horizon trop rigide. La flexibilité de l’evergreen répond à cette demande.
La réglementation européenne a joué un rôle clé. Avec la réforme ELTIF 2, entrée en vigueur en 2024, il est désormais possible de distribuer des fonds de capital-investissement à des clients non professionnels dans toute l’Union européenne (UE). Autrement dit, les particuliers peuvent investir dans des véhicules auparavant réservés aux fonds de pension ou aux grandes fortunes. Des acteurs comme Hamilton Lane, Carmignac ou Apollo ont déjà lancé des fonds evergreen sous ce format, cherchant à capter cette nouvelle clientèle.
Le modèle offre aussi un avantage technique : les capitaux sont investis et réinvestis en continu, ce qui évite les « dry powder » des fonds fermés, lorsque l’argent promis dort en attente d’être appelé. Résultat : le rendement peut bénéficier de l’effet de capitalisation dès le premier jour.
Une promesse et des pièges
La principale limite de l’evergreen réside dans la gestion de la liquidité. Comment offrir aux investisseurs la possibilité d’être « liquides », de sortir quand ils le souhaitent alors que les actifs sous-jacents (start-ups, PME, infrastructures) sont, eux, par définition illiquides ? Pour y parvenir, les fonds mettent en place des poches de liquidité, d’environ 20 % de la valeur liquidative (Net Asset Value, ou NAV), ou limitent les retraits à certains moments et pourcentages : c’est ce qu’on appelle les « gates ». Ces mécanismes fonctionnent en temps normal, mais peuvent s’avérer fragiles en cas de crise si trop d’investisseurs souhaitent se désinvestir en même temps.
La transparence est un autre enjeu. Dans un fonds evergreen, la valeur des participations est actualisée régulièrement et sert de base à la valorisation du fonds. Mais évaluer des sociétés non cotées reste délicat, et les méthodes employées peuvent varier d’un gérant à l’autre, malgré la réglementation. Le risque est de perdre la confiance des investisseurs en cas de baisse soudaine de la valeur liquidative, à la suite d’une valorisation pas assez conservatrice.
À lire aussi : Qui a peur d’investir en Afrique ?
Enfin, il n’existe pas encore de véritable historique de performance pour ce type de structures. Les grands fonds fermés bénéficient de décennies de recul et d’indicateurs normalisés comme le multiple de distribution (Distribution to paid-in, ou DPI). Les fonds evergreen, eux, mesurent leur performance sur un rendement annuel, difficile, par manque de recul, à interpréter avec finesse.
L’avenir du Private Equity ?
Le private equity traditionnel conserve donc de solides atouts et correspond au besoin de nombreux acteurs institutionnels. Mais les fonds evergreen apparaissent comme une solution complémentaire, mieux adaptée à certains investisseurs, qui ne sont pas en mesure de supporter une telle illiquidité ni la gestion des appels de fonds.
L’enjeu pour les GPs sera de trouver le bon équilibre. Trop de fluidité, et l’evergreen risque de perdre sa cohérence avec l’actif, par nature illiquide. Pas assez, et les investisseurs seront déçus. Les distributeurs devront eux aussi s’adapter pour expliquer ces subtilités à une clientèle élargie.
L’evergreen n’est pas une mode. Il porte une évolution structurelle du capital-investissement, vers plus d’accessibilité, de souplesse et de diversité. À condition de maîtriser ses risques, il pourrait devenir l’un des piliers de la finance privée européenne des prochaines décennies.